Notre inconscient est un étranger
Bien que notre inconscient émerge au sein de notre propre esprit, il est possible qu’il soit radicalement différent de nos pensées conscientes. Cela ferait de notre conscience et de notre inconscient deux étrangers aux identités bien différentes.
Il est difficile de concevoir qu’une chose pense sans en être consciente. Si vraiment l’âme d’un homme qui dort pense sans qu’il en soit conscient, je pose la question : ressent-elle plaisir ou douleur, est-elle capable de bonheur ou de malheur pendant qu’elle pense ainsi ? Je suis sûr que l’homme ne le peut pas, pas plus que le lit ou le sol sur lequel il repose. Car être heureux ou malheureux sans en être conscient me paraît totalement contradictoire et impossible.
Ou s’il était possible que l’âme ait, dans un corps endormi, des pensées, des joies, des soucis, des plaisirs et des peines séparés dont l’homme ne serait pas conscient, qu’il ne partagerait pas, il serait alors certain que Socrate endormi et Socrate éveillé ne seraient pas la même personne : son âme quand il dort, et l’homme Socrate pris corps et âme quand il est éveillé, seraient deux personnes distinctes.
En effet, Socrate éveillé n’a aucune connaissance ni aucun souci de ce bonheur ou de ce malheur que son âme seule éprouve, de son côté, tandis qu’il dort sans rien en percevoir ; il n’en aurait pas plus qu’à l’égard du bonheur ou du malheur d’un homme des Indes qu’il ne connaîtrait pas. Car si nous ôtons toute conscience de nos actions et de nos sensations, en particulier du plaisir et de la douleur, et du souci qui les accompagnent, il sera difficile de savoir où placer l’identité personnelle.
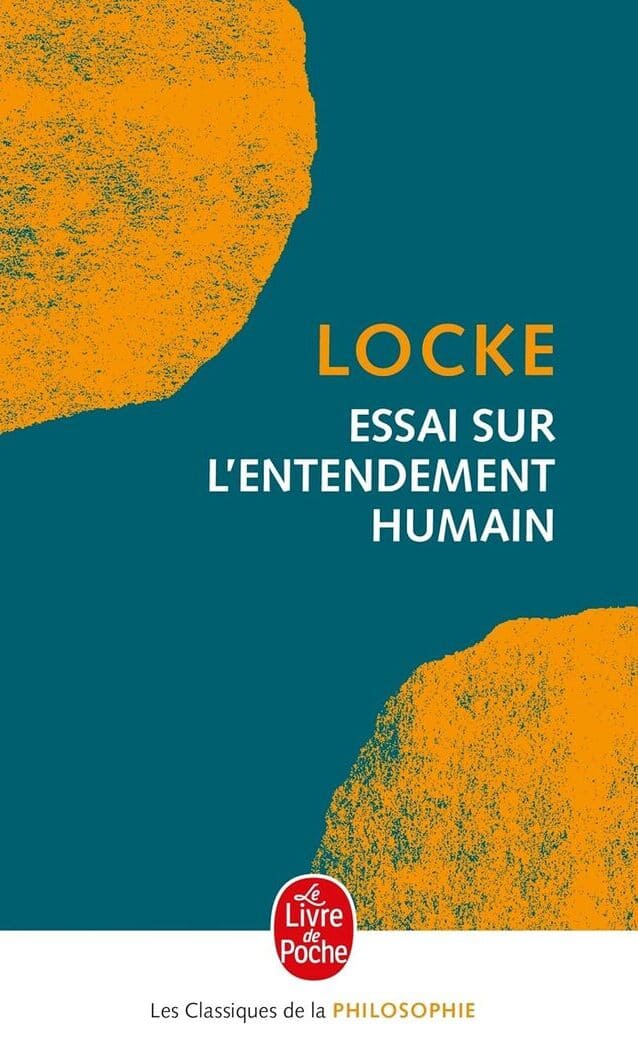
L'essentiel
Quand nous rêvons, nous sommes inconscients. Comme s’il existait un domaine inconnu dans lequel nous aurions des pensées gardées secrètes et séparées de notre conscience, aussitôt oubliées à notre réveil.
Mais dans ce cas, qui rêve ?
Est-ce toujours moi, avec mon identité consciente qui s’exprime sous une autre forme quand je dors ?
Ou est-ce un autre « moi », qui a sa propre identité, appartenant uniquement au domaine de l’inconscient ?
Notre identité personnelle est mise à mal par l’hypothèse même que certaines de nos pensées soient inconscientes.
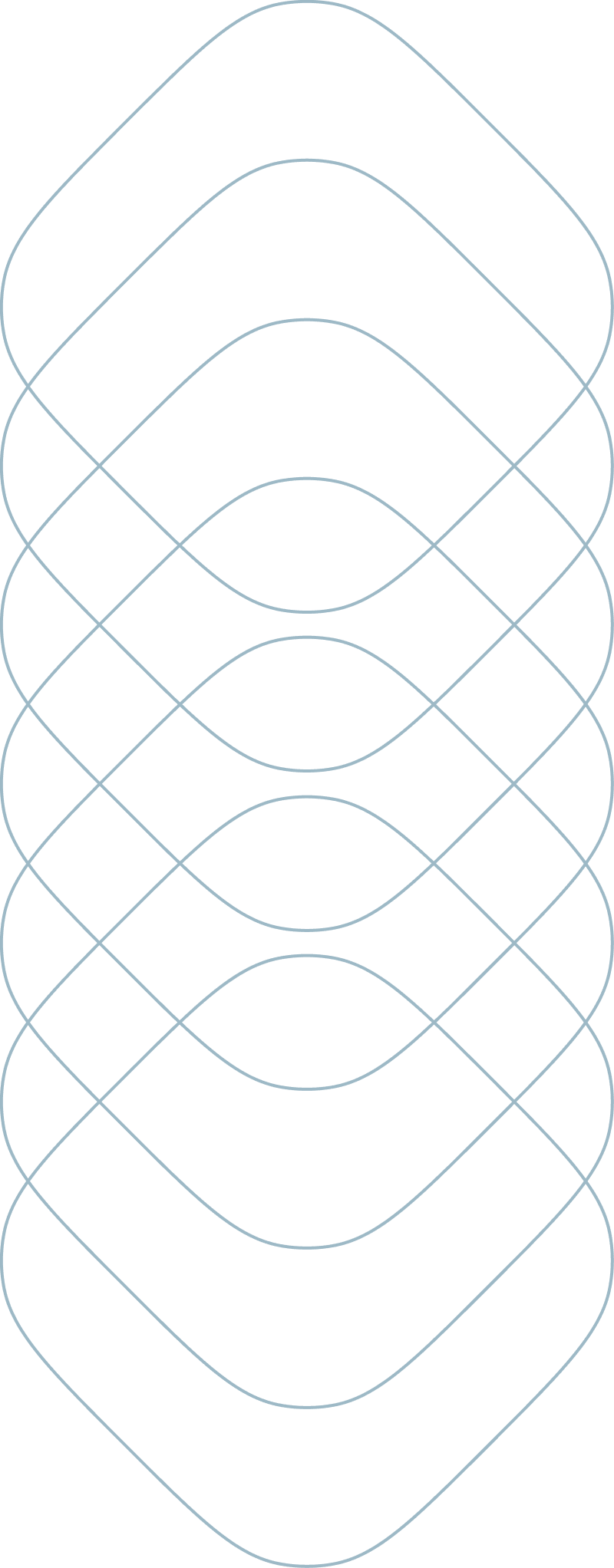
Des ressources pour aller plus loin
Penser l’identité
« La connaissance de l’homme ne saurait s’étendre au-delà de sa propre expérience. »
– Locke, Essai sur l’entendement humain
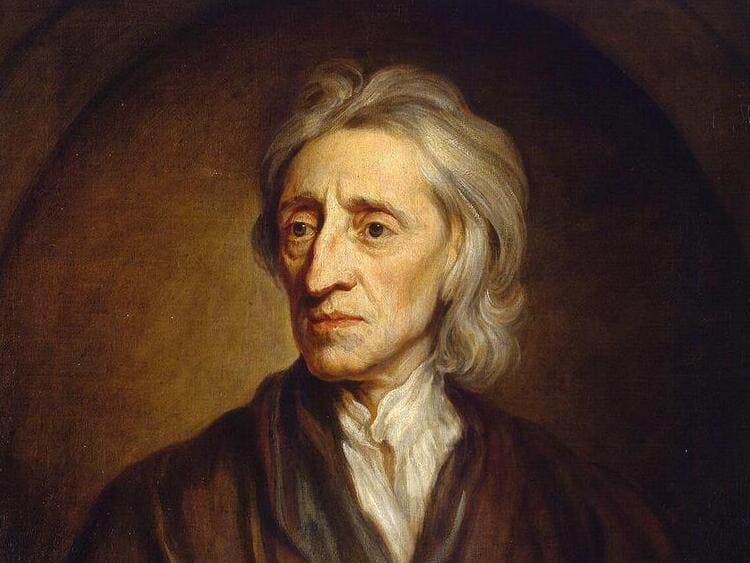
Podcast
John Locke : Une vie, une oeuvre
France Culture
[Bac Philo] : Cours et corrigés
Corrigé vidéo en détail [A venir]
Cours sur les théories de l'inconscient [A venir]

Résumé du corrigé :
Plan du texte
Première partie : Exposé d’une apparente absurdité (Paragraphe 1)
- De « Il est difficile… » à « …contradictoire et impossible. »
- La conscience et la pensée sont une même chose, alors dire que l’on pense dans nos rêves est contradictoire.
Deuxième partie : Approfondissement de la contradicton (Paragraphe 2)
- De « Ou s’il était possible… » à « …deux personnes distinctes. »
- Supposer qu’un corps endormi pense, c’est supposer qu’il a deux âmes qui cohabitent dans ce même corps : l’une quand il dort, l’autre quand il est éveillé.
Troisième partie : Conséquences de cette contradiction (Paragraphe 3)
- De « En effet, Socrate… » à « …identité personnelle. »
- L’hypothèse que l’on pense pendant notre sommeil remet en cause l’idée que l’on ait une identité personnelle bien définie.
Thèse du texte
La thèse principale de ce texte est que la conscience est indissociable de la pensée et constitue le fondement de l’identité personnelle.
|
Thèse adverse : L’âme est une substance immatérielle (Descartes) : que je dorme ou non, mon âme et mon identité restent inchangées. |
Problématique
Dans quelle mesure la conscience est-elle constitutive de l’identité personnelle ?
Intérêt philosophique et enjeux
💡Enjeux philosophiques sur l’immortalité de l’âme : Si l’identité personnelle repose sur la conscience, que devient-elle après la mort ?
💡Enjeux éthiques et juridiques : Si une personne n’est pas consciente de ses actes (comme pendant le sommeil), peut-on la tenir responsable de ses actions ?
Pièges et difficultés
🚫 Erreur 1 : Anachronisme : Appliquer des concepts contemporains de psychologie (comme l’inconscient freudien) à la pensée de Locke sans précaution, alors que ces concepts n’existaient pas à son époque.
🚫 Erreur 2 : Confusion sur la thèse centrale : Ne pas identifier correctement que, pour Locke, l’identité personnelle est fondée sur la conscience et non sur une substance immatérielle (l’âme).
🚫 Erreur 3 : Mauvaise interprétation de l’exemple de Socrate : Ne pas comprendre que l’exemple de « Socrate endormi » et « Socrate éveillé » est utilisé pour illustrer la thèse sur la conscience, et non pour discuter du sommeil en tant que tel.
Mobiliser ses connaissances
📌 John Locke – Connaître sa conception selon laquelle l’identité personnelle repose sur la conscience et la mémoire, développée principalement dans son « Essai sur l’entendement humain ».
📌 Descartes – Notre identité est fondée sur l’existence d’une substance pensante (notre âme)
Objections au texte
- L’existence des processus cognitifs inconscients : Les neurosciences contemporaines montrent que de nombreux processus mentaux se déroulent sans que nous en ayons conscience (perception subliminale, mémoire implicite, etc.). Ces découvertes semblent contredire l’affirmation de Locke sur l’impossibilité de penser sans conscience.
- L’objection du sommeil sans rêve : Pendant un sommeil profond sans rêve, la conscience semble s’interrompre. Selon Locke, serions-nous une personne différente avant et après ce sommeil ? Cette discontinuité de la conscience poserait alors un problème pour la continuité de l’identité.
Éléments pour l'introduction
Certains psychologues défendent l’idée que, si l’on bute sur un problème, il est possible de s’en écarter volontairement, en attendant qu’une bonne nuit de sommeil nous apporte, le lendemain, une solution à laquelle nous n’aurions pas pensée la veille. Cette théorie supposerait que, pendant notre sommeil, nous soyons capables de penser sans en être conscient. Mais dans ce cas, qui pense pendant la nuit ? Est-ce bien moi, sans que j’en sois vraiment conscient ? Cette réflexion soulève une problématique essentielle : dans quelle mesure la conscience est-elle constitutive de l’identité personnelle ? Pour le philosophe John Locke, la conscience est indissociable de la pensée et constitue le fondement de notre identité personnelle. Dans ce commentaire, nous analyserons d’abord cette thèse de Locke, puis nous explorerons les implications de sa conception de l’identité personnelle comme continuité de la conscience, pour enfin en évaluer les limites de cette thèse posées par la pensée contemporaine.




