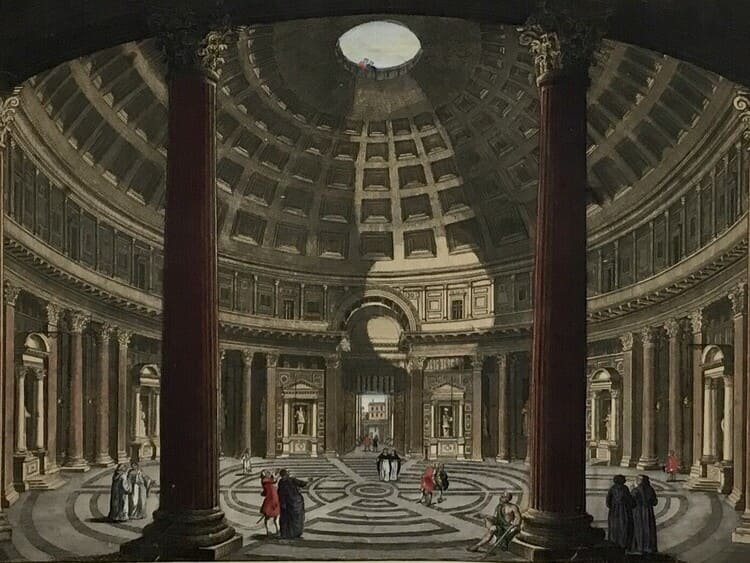L'Etat ne peut me forcer à être heureux
Le rôle de l’Etat est de créer les conditions pour que je puisse chercher mon bonheur par moi-même, pas de m’imposer sa propre vision du bonheur.
Personne ne peut me conduire à être heureux à sa manière (c’est-à-dire à la manière dont il conçoit le bien-être des autres hommes) ; par contre, chacun peut chercher son bonheur de la manière qui lui paraît bonne, à condition de ne pas porter préjudice à la liberté qu’a autrui de poursuivre une fin semblable (c’est-à-dire de ne pas porter préjudice au droit d’autrui), liberté qui peut coexister avec la liberté de chacun grâce à une possible loi universelle.
Un gouvernement qui serait fondé sur le principe de la bienveillance envers le peuple, comme celui d’un père envers ses enfants, c’est-à-dire un gouvernement paternaliste (…) où les sujets sont forcés de se conduire d’une manière simplement passive, à la manière d’enfants mineurs, incapables de distinguer ce qui leur est vraiment utile ou nuisible et qui doivent attendre simplement du jugement d’un chef d’État la manière dont ils doivent être heureux et simplement de sa bonté qu’également il le veuille, est le plus grand despotisme qu’on puisse concevoir (c’est-à-dire une constitution qui supprime toute liberté pour les sujet qui ainsi ne possèdent aucun droit).

L'essentiel
Un gouvernement doit-il « faire de la pédagogie » ? Imposer des mesures « pour le bien du peuple » ? Mettre en place des lois pour favoriser le bonheur des citoyens ?
Si tel est le cas, cela signifie que l’État est dirigé par des « parents » qui font en quelque sorte des lois pour leurs « enfants. » Et c’est là le signe d’une dictature, qui efface la liberté des citoyens au nom d’un bonheur collectif qu’ils n’ont pas choisi.
Car qui décide ce qu’est le bonheur ? D’après quels critères ? Imposés par qui ?
Pour Kant, le rôle de l’Etat est de créer les conditions pour que chacun puisse chercher son propre bonheur sans menacer la liberté de son voisin.
Pour l’Etat la défense de la liberté doit donc primer sur la défense du bonheur.
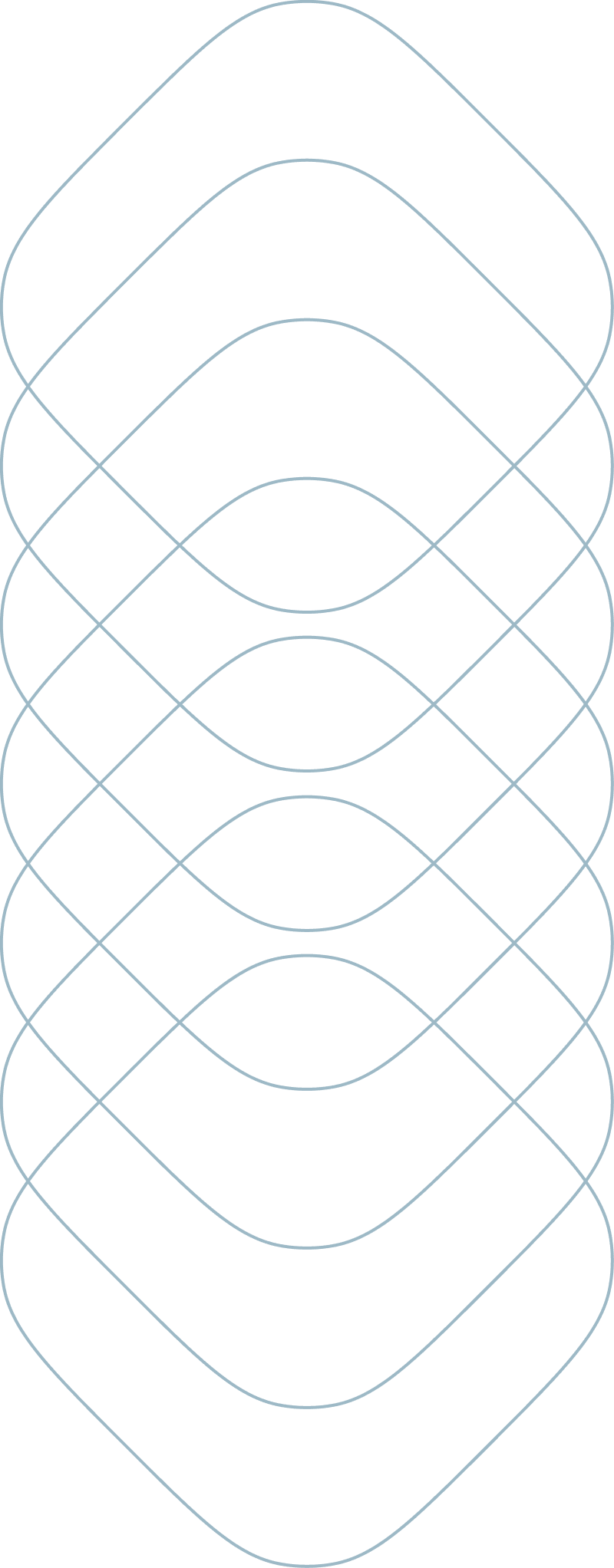
Des ressources pour aller plus loin
L’État libéral
« Le despotisme est le gouvernement où le chef de l’État exécute arbitrairement les lois qu’il s’est données à lui-même, et où, par conséquent, il substitue sa volonté particulière à la volonté publique. »
– Kant, Vers la paix perpétuelle
[Bac Philo] : Cours et corrigés
Corrigé vidéo en détail [A venir]
Cours sur l'Etat et la liberté [A venir]

Résumé du corrigé :
Plan du texte
Première partie : Chacun est responsable de son propre bonheur (Paragraphe 1)
- De « Personne ne peut… » à « …possible loi universelle ».
- Kant énonce que le bonheur est une affaire personnelle…
- …à condition de respecter la liberté d’autrui.
Deuxième partie : Un Etat qui cherche à me rendre heureux est despotique (Paragraphe 2)
- De « Un gouvernement qui… » à « ..ne possèdent aucun droit. »
- Imposer une vision du bonheur au peuple, c’est l’infantiliser.
- En l’infantilisant, on lui ôte tout liberté.
Thèse du texte
Kant soutient que chaque individu doit être libre de poursuivre son propre bonheur selon sa propre conception, sans qu’autrui puisse lui imposer une manière d’être heureux.
|
Thèses adverses : 1) Jean-Jacques Rousseau : la volonté générale (qui défend uniquement l’intérêt commun des citoyens) doit gouverner l’Etat. 2) John Stuart Mill : l’Etat doit maximiser le bonheur de la société en ignorant les égoïsmes individuels. |
Problématique
L’Etat est-il un défenseur ou un obstacle à notre bonheur ?
Intérêt philosophique et enjeux
💡Enjeux sur la définition du bonheur : Dans des sociétés de plus en plus multiculturelles, il existe de nombreuses définitions différentes du bonheur. Si l’Etat en défend une, le fait-il au dépend des autres ?
💡Enjeux concrets sur la santé publique : L’Etat peut-il taxer les drogues (comme l’alcool et le tabac) pour empêcher les citoyens d’en consommer ? Plus polémique encore : doit-il imposer la prise d’un vaccin pour le bien de tous ?
Pièges et difficultés
🚫 Erreur 1 : Confondre la critique du paternalisme avec un rejet de toute intervention étatique. Kant ne défend pas un État minimal ou un libertarien ; il critique la manière dont l’État impose une conception du bonheur, mais accepte bien des interventions étatiques qui protègent les libertés.
🚫 Erreur 2 : Voir dans ce texte une défense de l’égoïsme ou de l’individualisme radical. Kant ne prône pas que chacun poursuive son intérêt sans limite, mais défend une liberté compatible avec celle des autres via une « loi universelle ».
🚫 Erreur 3 : Faire un anachronisme en négligeant le contexte historique du texte. Kant critique le despotisme éclairé du XVIIIe siècle, pas l’État-providence d’aujourd’hui. Son enjeu philosophique fondamental est la défense de la liberté, en suivant l’esprit des Lumières.
Mobiliser ses connaissances
📌 Kant – Loi morale et impératif catégorique : pour Kant, la première limite à la recherche égoïste du bonheur est le respect de notre devoir, qui dépend de nous et pas de l’Etat.
📌 Rousseau – La volonté généralel : l’État peut légitimement contraindre les citoyens dans leur intérêt collectif.
Objections au texte
- Le problème des inégalités : Le texte ne prend pas en compte comment les inégalités économiques et sociales peuvent entraver la liberté des plus défavorisés. La non-intervention de l’État peut perpétuer ces inégalités.
- La complexité des choix modernes : Dans un monde technologique complexe, les individus peuvent manquer d’expertise pour faire des choix éclairés (en santé, finance, écologie). Une certaine guidance étatique peut être nécessaire sans constituer un despotisme.
Éléments pour l'introduction
Quand l’Etat promeut des politiques sur la santé publique, il cherche à guider notre quête de bonheur. Par exemple, mon paquet de cigarettes participe à la satisfaction d’un désir quotidien, mais l’Etat sait que, sur le long terme, cette mauvaise habitude va avoir des effets sur mon bonheur, en écourtant ma vie et en me causant de nombreuses maladies. Comme un bon père de famille, il me répète alors quotidiennement que « la cigarrette est une drogue », et met des obstacles sur mon chemin pour m’encourager à arrêter de fumer. Mais est-ce vraiment son rôle ?
Dans ce texte, Kant aborde une question fondamentale de la philosophie politique : celle des limites légitimes de l’action de l’État sur la liberté des individus. L’Etat peut-il m’imposer sa définition du bonheur ? Et en limitant ainsi mes libertés, est-il un garant ou plutôt une menace à mon bonheur ? Kant s’oppose au paternalisme de l’Etat et défend une conception de la liberté individuelle où chacun doit pouvoir poursuivre sa propre conception du bonheur sans qu’autrui puisse lui imposer une façon d’être heureux. Cette position s’inscrit dans le projet des Lumières d’émanciper l’homme de toute tutelle qui l’empêcherait de penser et d’agir par lui-même. Nous analyserons d’abord comment Kant critique le paternalisme d’Etat, puis les limites qu’il pose lui-même à la recherche égoïste du bonheur, et enfin nous questionneron la pertinence de cette conception face aux défis politiques contemporains.