La beauté est une forme qui produit du plaisir
Le jugement de goût repose sur le plaisir que nous procure une belle chose. Et ce plaisir naît d’une forme particulière, dont la composition, l’ordre et la convenance, touchent notre esprit.
La beauté est un ordre et une combinaison de parties, tels que, par la constitution primitive de notre nature, par accoutumance ou par caprice, elle est propre à donner à l’âme un plaisir et un contentement. C’est là le caractère distinctif de la beauté : c’est ce qui constitue la différence qui existe entre elle et la laideur dont la tendance naturelle est de produire un malaise. Le plaisir et la douleur ne sont donc pas seulement les compagnons nécessaires de la beauté et de la laideur, ils en constituent l’essence même.
Et certes si nous considérons qu’une grande partie de la beauté, que nous admirons chez les animaux et dans les objets, dérive de l’idée de convenance et d’utilité, nous n’hésiterons pas à consentir à cette opinion. Cette forme, qui produit la force, est belle chez un animal ; et cette autre, qui est signe d’agilité, l’est chez un autre. L’ordre et la convenance d’un palais ne sont pas moins essentiels à sa beauté que sa forme même et son aspect. De même manière, les règles de l’architecture requièrent que le haut d’un pilier soit plus mince que sa base, parce qu’une telle forme nous apporte l’idée de sécurité, qui est agréable ; au contraire la forme opposée nous fait craindre un danger, ce qui est pénible.
D’innombrables exemples de ce genre, aussi bien que la remarque que la beauté, comme l’esprit, ne peut se définir, mais qu’on la discerne seulement par un goût ou une sensation, nous permettent de conclure que la beauté n’est rien qu’une forme qui produit le plaisir.
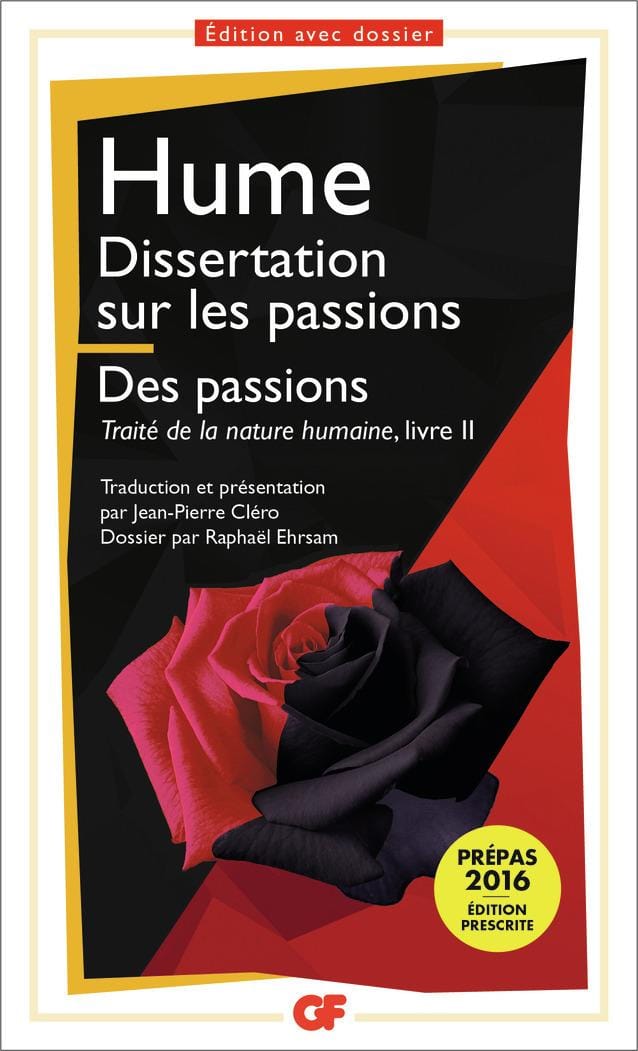
L'essentiel
Quel est le point commun entre une belle maison, un beau tableau et une belle chanson ?
Tous trois nous donnent du plaisir. c’est-à-dire une satisfaction de nos sens et de notre esprit.
Comme chacun est différent, ses goûts et son plaisir le sont aussi. Peut-on alors dire que toute beauté et relative ?
Pas tout à fait selon Hume, car pour lui le plaisir agréable que nous éprouvons face à la beauté repose sur d’autres critères, comme la forme, l’ordre ou encore la combinaison des parties.
C’est pourquoi la beauté peut être à la fois toute relative (elle dépend du goût de chacun) mais aussi le fruit de critères plus généraux (par exemple les règles des formes qui provoquent du plaisir).
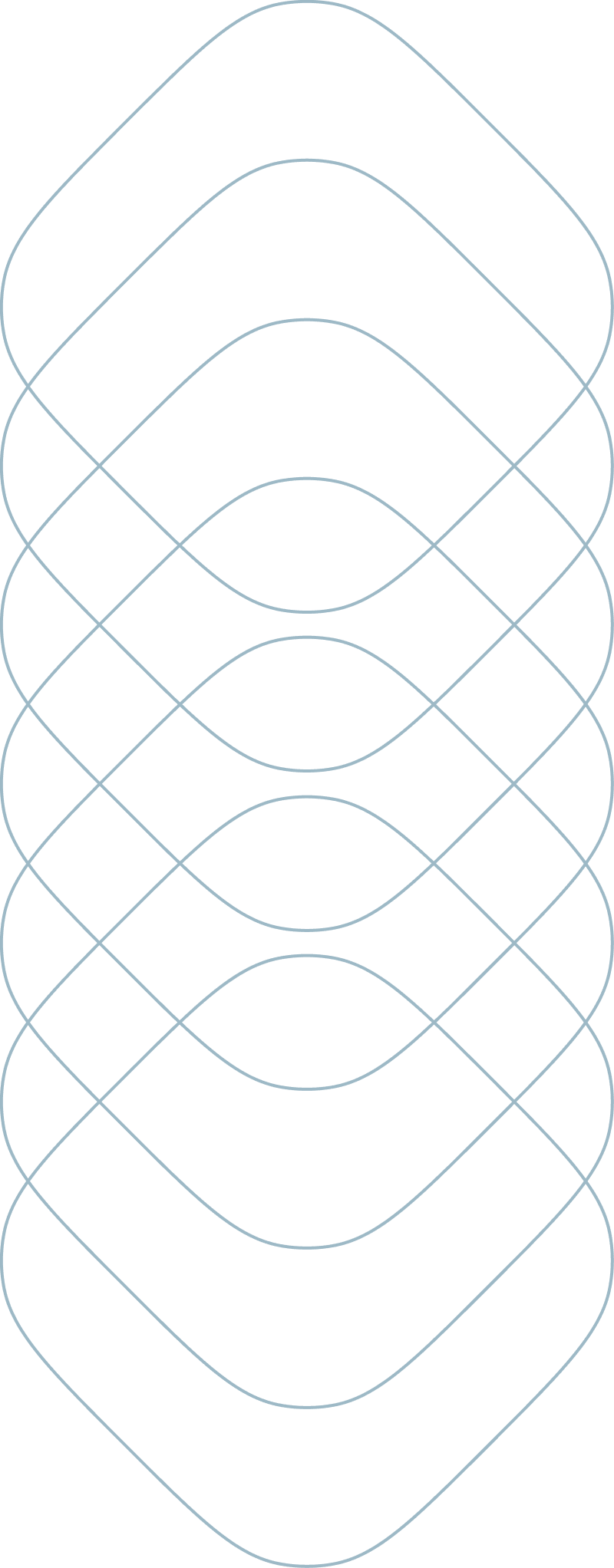
Des ressources pour aller plus loin
La beauté comme plaisir
« La beauté n’est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l’esprit qui la contemple. »
– Hume, De la norme du goût
[Bac Philo] : Cours et corrigés
Corrigé vidéo en détail [A venir]
Cours sur les définitions du beau en philosophie [A venir]

Résumé du corrigé :
Plan du texte
Première partie (premier paragraphe): Définition de la beauté comme un ordre harmonieux qui procure du plaisir:
Hume définit la beauté comme un agencement harmonieux de parties qui provoque naturellement du plaisir, alors que la laideur suscite du malaise.
Deuxième partie (deuxième paragraphe): Lien entre beauté et utilité: la perception du beau est influencée par la convenance et l’adaptation.
Hume explique que nous trouvons belles les formes qui sont perçues comme utiles ou adaptées à une fonction.
Il illustre cette idée avec des exemples concrets : la force physique d’un animal, l’agilité, ou encore l’architecture où la perception de stabilité inspire du plaisir, alors que l’inverse génère de l’inquiétude.
Troisième partie (troisième paragraphe) : Conclusion : la beauté est une sensation subjective, insaisissable par une définition stricte.
Thèse du texte
Hume soutient que la beauté n’est rien d’autre qu’une source de plaisir, sans essence absolue.
|
Thèse adverse : ⚔️Platon et l’objectivité de la beauté : Dans « Le Banquet », Platon soutient que la beauté repose sur des Idées éternelles et absolues. Contrairement à Hume, il défend l’existence d’une beauté universelle indépendante des préférences individuelles. |
Problématique
La beauté est-elle une qualité intrinsèque des objets ou dépend-elle uniquement du ressenti subjectif ?
Intérêt philosophique et enjeux
💡Enjeu sociologique : Si la beauté est subjective, cela implique que nos goûts et préférences sont influencés par notre éducation et notre environnement.
💡Enjeu scientifique : Nos jugements esthétiques sont-ils liés à des mécanismes biologiques ?
💡Enjeu artistique : Si la beauté n’est qu’un effet subjectif, alors l’art n’a pas de normes absolues et dépend entièrement du jugement des spectateurs.
Pièges et difficultés
🚫 Erreur 1 : Réduire la beauté à une simple sensation individuelle
La beauté a certes une dimension subjective, mais elle repose aussi sur des critères souvent partagés (harmonie, proportions, etc.). L’expérience esthétique engage aussi l’intellect.
🚫 Erreur 2 : Dire que Hume a une vision totalement relativiste du jugement esthétique
Dire que le beau apporte un plaisir personnel ne signifie pas que la beauté est totalement arbitraire. Par exemple, quelqu’un peut reconnaître qu’une œuvre est belle sans l’apprécier personnellement. Le jugement esthétique n’est pas complètement relatif.
🚫 Erreur 3 : Ne pas faire remarquer que Hume parle de « règles » dans l’art
La sensation de convenance dont parle Hume donne lieu à des règles dans l’art. Il donne l’exemple de l’architecture, mais on peut citer d’autres règles (comme celle de la perspective en peinture ou des 180° au cinéma). Encore une fois, Hume n’a donc pas un jugement relativiste de l’art.
Mobiliser ses connaissances
📌 Kant et le jugement esthétique : Dans « Critique de la faculté de juger », Kant affirme que le beau est subjectif mais qu’il possède une forme de validité universelle, car le jugement esthétique repose sur un sentiment partagé par tous les hommes.
📌Nietzsche et la glorification de l’homme : Nietzsche met en avant le beau comme expression de la vie et de la pleine puissance de l’homme accompli.
Objections au texte
Une explication trop réductrice de l’expérience esthétique
Hume insiste sur l’impact de l’utilité dans la perception de la beauté, mais cette vision fonctionnelle ne tient pas compte de l’art abstrait, qui ne repose sur aucune utilité immédiate.
La beauté peut-elle être réduite au plaisir ?
Hume assimile la beauté au plaisir qu’elle procure, mais cette conception peut être critiquée : certaines œuvres sont jugées belles même si elles suscitent des émotions négatives (mélancolie, terreur). Une œuvre tragique peut être sublime sans pour autant produire un plaisir immédiat.
Éléments pour l'introduction
Lorsqu’un nouveau film sort à l’affiche, les critiques de cinéma proposent de dire si, oui ou non, c’est une œuvre belle et réussie. Mais au nom de quoi leur opinion aurait-elle plus de valeur qu’une autre ? Certains défendent l’idée qu’un chef d’œuvre du cinéma est beau en soi. C’est-à-dire qu’il a des qualités intrinsèques (photographie, montage, scenario) qui lui donnent une beauté objective. Mais est-ce vraiment le cas ? Ou est-ce que les critiques de cinéma ne font au final que donner leur avis ? En d’autres termes : La beauté est-elle une qualité intrinsèque des objets ou dépend-elle uniquement du ressenti subjectif ? Dans ce texte extrait du « Traité de la nature humaine », David Hume défend une conception subjectiviste de la beauté : il affirme que celle-ci ne réside pas dans les objets eux-mêmes, mais dans la sensation de plaisir qu’ils provoquent chez celui qui les perçoit. Pour appuyer son propos, il montre que notre jugement esthétique est influencé par des critères de convenance et d’utilité. Enfin, il conclut que la beauté se réduit à une expérience de plaisir sensoriel. Ce texte pose ainsi la question fondamentale de la nature de la beauté et de son rapport à nos sensations. Nous verrons d’abord comment Hume construit son argumentation, avant d’examiner les critiques possibles de cette thèse.





