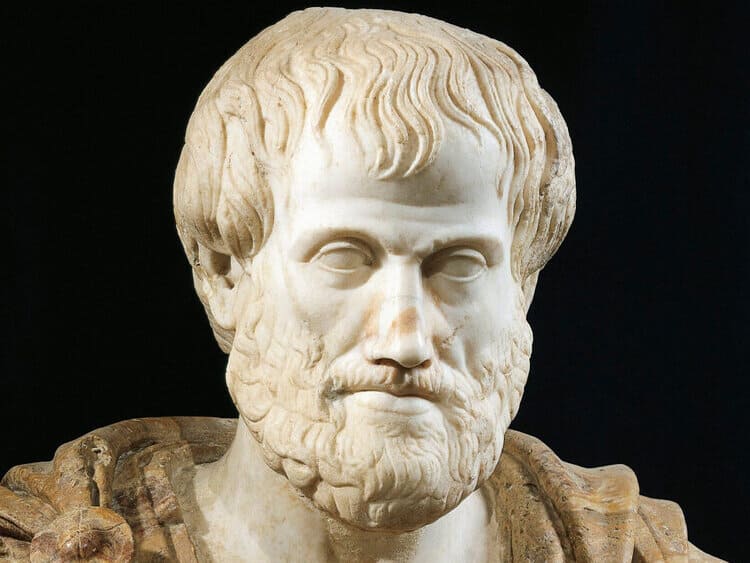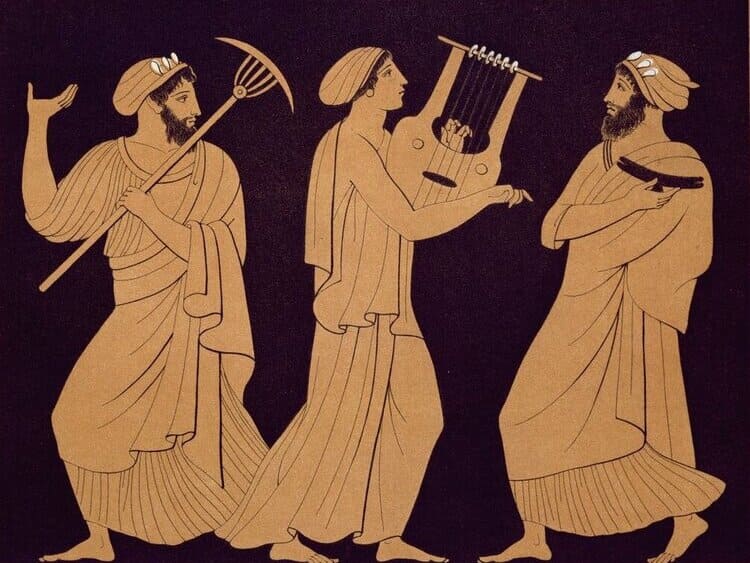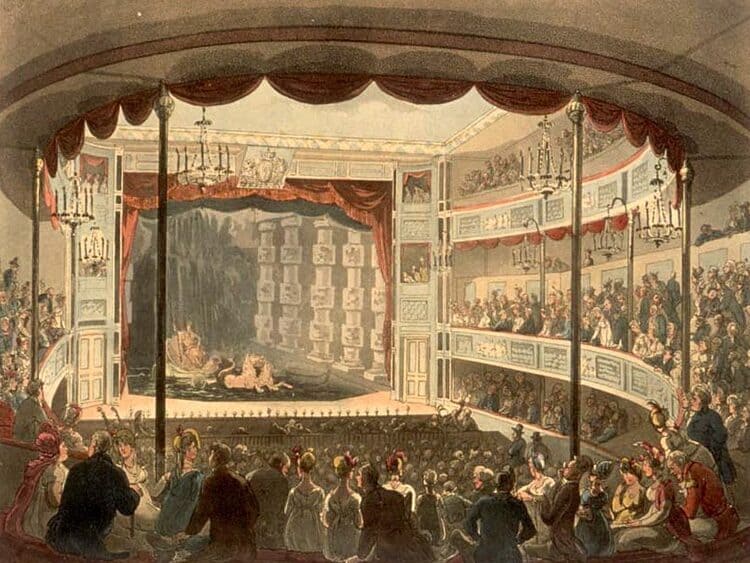Le plaisir d'imiter
L’imitation [μίμησις / mímêsis], ou la représentation, est un plaisir universel qui s’explique par la curiosité naturelle des êtres humains et leur désir de connaissance.
Imiter est naturel aux hommes et se manifeste dès leur enfance (l’homme diffère des autres animaux en ce qu’il est très apte à l’imitation et c’est au moyen de celle-ci qu’il acquiert ses premières connaissances). Et tous les hommes prennent plaisir aux imitations.
Un indice est ce qui se passe dans la réalité : des êtres dont l’original fait peine à la vue, nous aimons à en contempler l’image exécutée avec la plus grande exactitude ; par exemple les formes des animaux les plus vils et des cadavres.
Une raison en est encore qu’apprendre est très agréable non seulement aux philosophes mais pareillement aussi aux autres hommes ; seulement ceux-ci n’y ont qu’une faible part. On se plaît à la vue des images parce qu’on apprend en les regardant et on déduit ce que représente chaque chose, par exemple que cette figure c’est un tel. Si on n’a pas vu auparavant l’objet représenté, ce n’est plus comme imitation que l’œuvre pourra plaire, mais à raison de l’exécution, de la couleur ou d’une autre cause de ce genre.
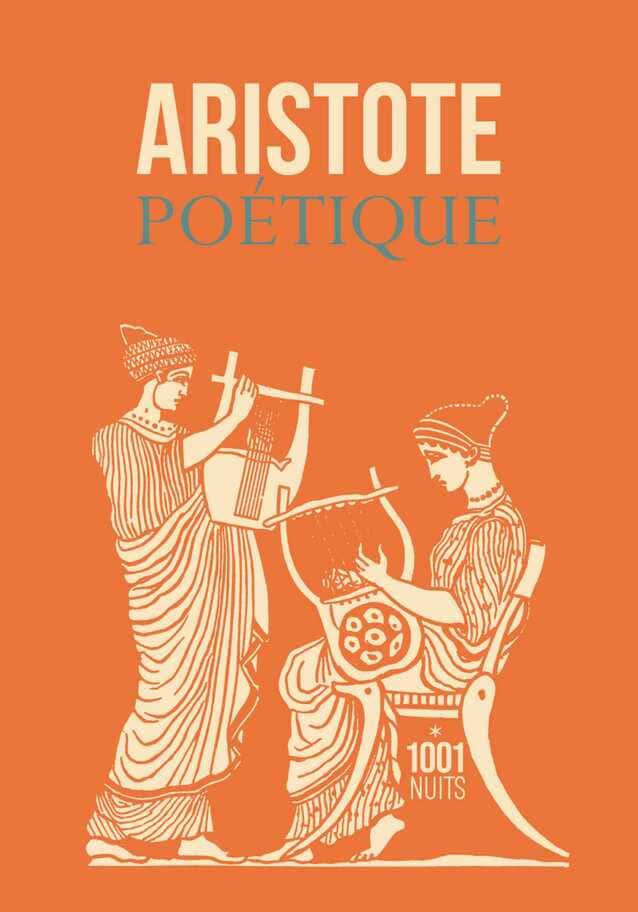
L'essentiel
Pourquoi aimons-nous les films d’horreur ?
Jamais, dans la réalité, nous ne prendrions du plaisir à voir des scènes gores. Et la simple vue du vrai sang pourrait nous causer un malaise.
Mais lorsque ces mêmes scènes sont représentées, avec des acteurs, des décors et du faux sang, nous y prenons étrangement plaisir. Est-ce de la perversité ?
Pour Aristote, c’est simplement que les êtres humains ont un plaisir inné à imiter ou voir des imitations. Nous pouvons tout d’abord prendre du plaisir à reconnaître ce qui est imité, puis à admirer les qualités de l’imitation, et enfin à apprendre grâce aux imitations.
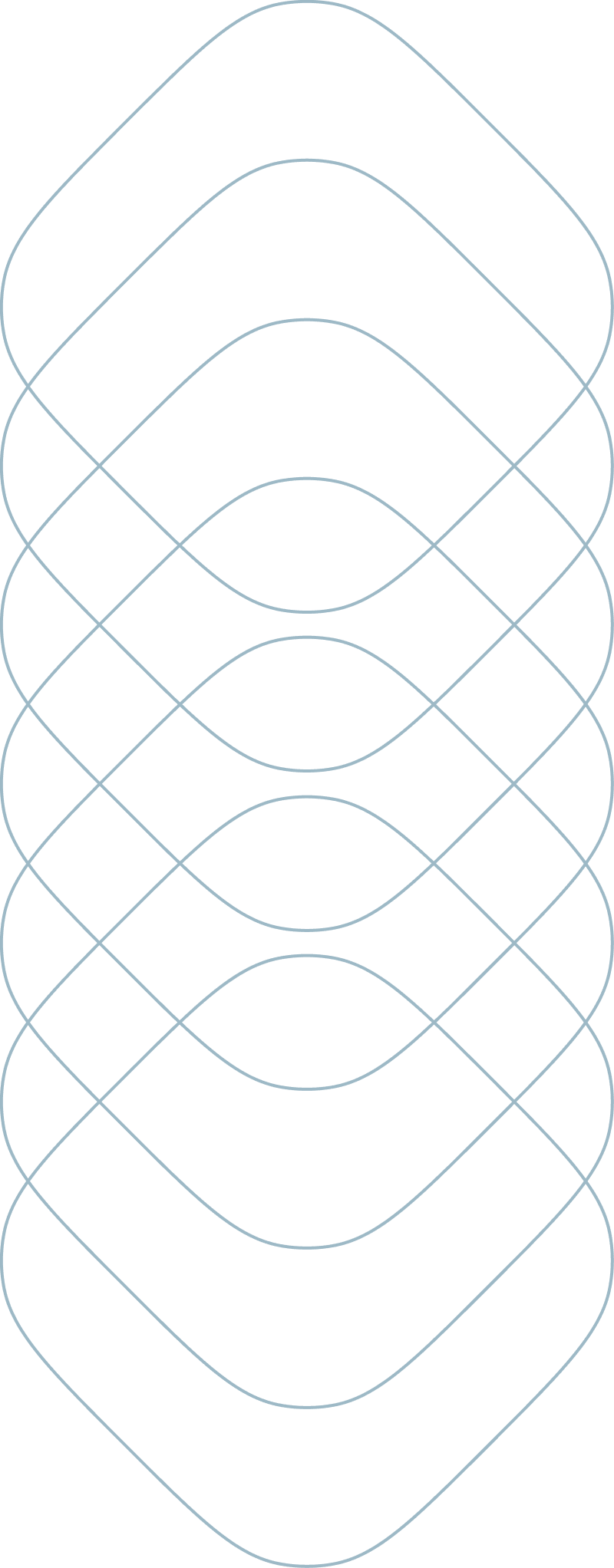
Des ressources pour aller plus loin
L’art comme imitation
« Tous les hommes ont, par nature, le désir de connaître ; le plaisir causé par les sensations en est la preuve, car, en dehors même de leur utilité, elles nous plaisent par elles-mêmes, et, plus que toutes les autres, les sensations visuelles. »
– Aristote, Métaphysique, A, 1
[Bac Philo] : Cours et corrigés
Corrigé vidéo en détail [A venir]
Cours sur l'art [A venir]

Résumé du corrigé :
Plan du texte
Première partie : L’imitation comme caractéristique humaine et source de plaisir universel (« Imiter est naturel aux hommes… plaisir aux imitations »).
Aristote affirme que l’imitation est une faculté naturelle, propre à l’homme, et qu’elle est présente dès l’enfance.
Cette faculté est aussi un moyen d’apprentissage et une source de plaisir.
Deuxième partie : L’exemple de la réaction esthétique aux images de choses déplaisantes (« Un indice est ce qui se passe… des cadavres »).
L’auteur illustre son idée par un exemple : nous pouvons prendre plaisir à observer toutes sortes d’imitations, même celle de choses répugnantes dans la réalité.
Cela suggère que le plaisir ne provient pas de la représentation elle-même mais du fait qu’elle est une imitation.
Troisième partie : L’explication du plaisir que procure l’imitation (« Une raison en est encore… ou d’une autre cause de ce genre »).
L’imitation suscite du plaisir car elle est une forme d’apprentissage par l’expérience.
Notre plaisir vient soit de ce que l’on reconnaît les choses imitées, soit que l’on apprécie la technique ou les qualités esthétiques de l’imitation (plaisir de la reconnaissance et plaisir de la pure exécution artistique).
Thèse du texte
Aristote soutient que l’imitation est un plaisir universel qui joue un rôle clé dans l’éducation des êtres humains.
Problématique
L’imitation est-elle une activité triviale, ou a-t-elle une véritable valeur ?
Intérêt philosophique et enjeux
💡Enjeu psychologique : Comment l’imitation contribue-t-elle à notre développement intellectuel ?
💡Enjeu éducatif : Si l’imitation est le fondement de l’apprentissage humain, pourquoi n’est-elle pas aujourd’hui le socle de notre éducation ?
💡Enjeu esthétique: L’art peut-il être résumé à un moyen de connaissance ou une source de plaisir ?
Pièges et difficultés
🚫 Erreur 1 : Réduire l’imitation à l’art pictural
Le texte parle d’imitation en général, pas seulement en peinture. Il ne faut pas négliger son rôle dans d’autres domaines (théâtre, littérature, cinéma, etc.).
🚫 Erreur 2 : Confondre imitation et simple reproduction
Pour Aristote, l’imitation n’est pas forcément une copie servile mais une re-création qui peut apporter une vision originale.
🚫 Erreur 3 : Oublier la dimension émotionnelle de l’art
Le plaisir artistique ne vient pas seulement de la reconnaissance intellectuelle, mais aussi de l’émotion et de l’esthétique.
Mobiliser ses connaissances
📌 Kant (Critique de la faculté de juger) : Le génie, dans l’art, est non pas d’imiter mais de créer des œuvres originales.
📌 Hume (théorie du goût) : Hume défend une conception subjective du plaisir esthétique, qui repose sur la perception individuelle.
Objections au texte
La thèse est-elle applicable à toutes les formes d’art ?
L’argumentation repose sur des exemples picturaux. Qu’en est-il de l’abstraction et des formes artistiques qui ne représentent rien de reconnaissable ?
Une conception trop intellectuelle du plaisir artistique ?
Le texte suppose que le plaisir vient essentiellement de la reconnaissance et de l’apprentissage. Quelle est la part de l’émotion dans ce plaisir ?
Éléments pour l'introduction
Le gore, le body horror ou le slasher sont des sous-genre de film d’horreur qui ont un point commun : représenter de la violence à l’écran, de façon outrancière et esthétique. Mais comment se fait-il que des personnes puissent apprécier ce genre de film ? Quel plaisir peut-il y avoir à regarder des gerbes d’hémoglobine ? Certains cinéphiles vont jusqu’à snober le genre de l’horreur, en le trouvant plat et sans intérêt. Car à quoi bon représenter des meurtres ? Peut-on vraiment trouver un intérêt à de telles imitations, ou est-ce un passe-temps trivial et vulgaire ? Le texte que nous allons analyser tente de répondre à cette question en affirmant que l’imitation est une faculté naturelle chez l’homme, qui procure du plaisir en raison de sa dimension éducative. Autrement dit, nous aimons naturellement les représentations parce qu’elles nous permettent d’apprendre et de reconnaître le monde. Nous verrons d’abord pourquoi Aristote fait de l’imitation un fondement de l’apprentissage, avant d’examiner la relation entre mimêsis et plaisir, et enfin de discuter les critiques possibles de cette conception.