S'acquitter de son devoir rend heureux
Nos passions, même les plus nobles, ne savent nous rendre plus heureux que la droiture du devoir.
La différence qui est entre les plus grandes âmes et celles qui sont basses et vulgaires, consiste, principalement, en ce que les âmes vulgaires se laissent aller à leurs passions, et ne sont heureuses ou malheureuses, que selon que les choses qui leur surviennent sont agréables ou déplaisantes ; au lieu que les autres ont des raisonnements si forts et si puissants que, bien qu’elles aient aussi des passions, et même souvent de plus violentes que celles du commun, leur raison demeure néanmoins toujours la maîtresse, et fait que les afflictions même les servent, et contribuent à la parfaite félicité dont elles jouissent dès cette vie.
[…] Ainsi, ressentant de la douleur en leur corps, elles s’exercent à la supporter patiemment, et cette épreuve qu’elles font de leur force, leur est agréable ; ainsi, voyant leurs amis en quelque grande affliction, elles compatissent à leur mal, et font tout leur possible pour les en délivrer, et ne craignent pas même de s’exposer à la mort pour ce sujet, s’il en est besoin. Mais, cependant, le témoignage que leur donne leur conscience, de ce qu’elles s’acquittent en cela de leur devoir, et font une action louable et vertueuse, les rend plus heureuses, que toute la tristesse, que leur donne la compassion, ne les afflige.
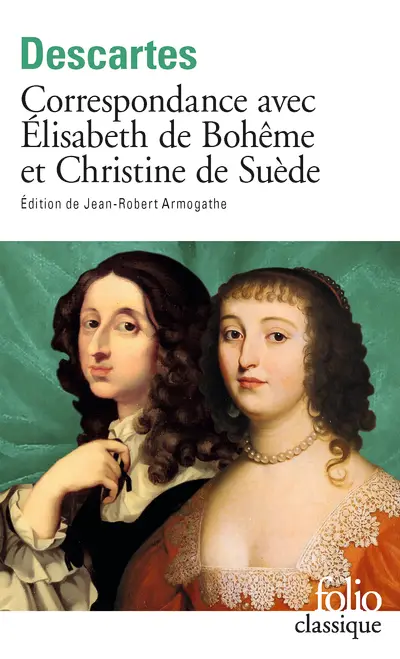
L'essentiel
Le mot « passion » a pour Descartes un sens différent de celui qu’il a pour nous aujourd’hui.
En effet, à l’époque, on parlait de passions pour désigner les sentiments ou les émotions. Et l’on distinguait par exemples les passions agréables (comme la joie) des passions désagréables (comme la tristesse).
Dans ce contexte, Descartes définit le devoir comme le fait de ne pas céder à ses passions.
En effet, nos passions nous font vivre dans un état de changement émotionnel permanent, qui nous éloigne du bonheur.
Tandis que le devoir, cap moral imposé par notre faculté de raisonner, reste invariable, et nous satisfait toujours quand on l’accomplit.
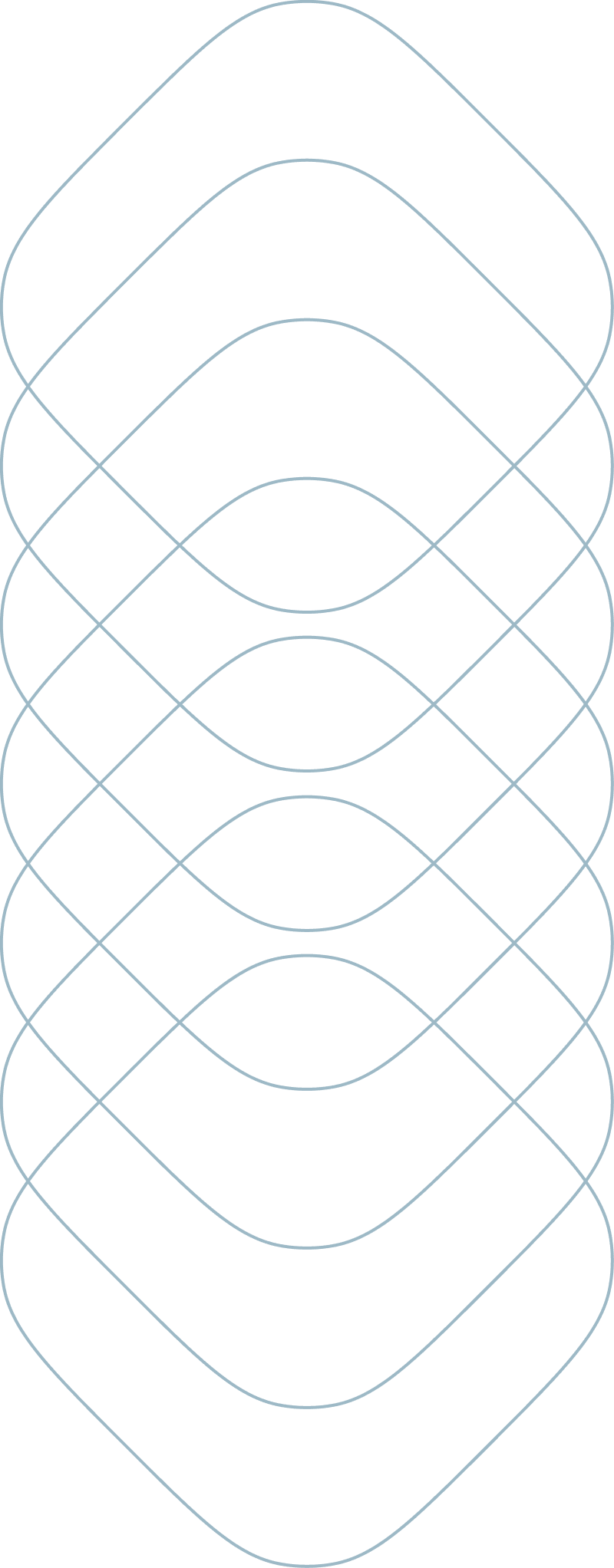
Des ressources pour aller plus loin
Morale et raison
« Tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs plutôt que l’ordre du monde. »
– Descartes, Discours de la méthode (Troisième maxime de la morale provisoire)
[Bac Philo] : Cours et corrigés
Corrigé vidéo en détail [A venir]
Cours sur la relation entre la raison et les passions [A venir]

Résumé du corrigé :
Plan du texte
Première partie (1er paragraphe, de « La différence qui… » à « dès cette vie ») :
- Opposition entre les âmes vulgaires dominées par leurs passions et les grandes âmes guidées par la raison.
Deuxième partie (2nd paragraphe, de « Ainsi, ressentant… » à « ne les afflige. »)
- Exemples concrets de la maîtrise des passions.
- Le bonheur d’accomplir son devoir est un moteur bien plus fort que la compassion.
Thèse du texte
La raison permet aux grandes âmes de tempérer les passions et de trouver du bonheur dans leur devoir, alors que les âmes vulgaires sont prisonnières des aléas de leurs plaisirs.
|
Thèses adverses : 1) Hédonisme (Epicure) : Le bonheur réside non pas dans le respect du devoir mais plutôt dans la satisfaction des plaisirs naturels et nécessaires. 2) Stoïcisme (Epictète) : On ne peut pas prétendre qu’une douleur devienne agréable, mais plutôt qu’on peut choisir de s’en détacher. |
Problématique
Les privations que nous infligent le devoir ne risquent-elles pas de nous rendre malheureux ?
Intérêt philosophique et enjeux
💡Enjeu existentiel : Faut-il chercher le vrai bonheur dans l’obtention de plaisirs extérieurs ou au sein d’une sagesse intérieure ?
💡Enjeux psychologique : Peut-on vraiment écarter nos émotions négatives, par exemple notre désir de vengeance ?
Pièges et difficultés
🚫 Erreur 1 : Confondre maîtrise des passions et absence de sentiments
❌ Croire que Descartes conseille de devenir insensible.
✅ En réalité, il valorise le contrôle et non la suppression des émotions.
🚫 Erreur 2 : Penser que le bonheur chez Descartes est purement intellectuel
❌ Réduire la félicité à un simple exercice de la raison.
✅ Le bonheur inclut la satisfaction morale et le bien-être global.
🚫 Erreur 3 : Négliger l’importance du devoir et de la vertu
❌ Voir le texte uniquement comme une leçon de gestion du stress.
✅ Il s’agit avant tout de vivre selon des principes justes, même au prix de sacrifices.
Mobiliser ses connaissances
📌 Stoïcisme (Epictète) : Epictète partage avec Descartes l’idée que la raison doit dominer les passions. Cependant, il va plus loin en cherchant à les ignorer totalement. Là où Descartes valorise la régulation des passions, Epictète privilégie le détachement.
📌 Épicure et l’hédonisme raisonné : Pour Épicure, le bonheur repose sur la recherche de plaisirs modérés et l’évitement des douleurs inutiles. Contrairement à Descartes, qui semble ici accepter la souffrance comme outil de perfectionnement, Épicure recommande de la fuir si elle ne mène pas à un plaisir supérieur.
Objections au texte
1. Une vision exigeante mais difficilement applicable
Descartes semble supposer que la raison peut toujours dominer les passions. Mais peut-on réellement contrôler toutes ses émotions, notamment dans les situations extrêmes ?
2. Objection psychologique contemporaine
Les neurosciences modernes montrent que certaines réactions émotionnelles sont involontaires et difficilement contrôlables. Peut-on réellement dominer toutes ses passions ?
Éléments pour l'introduction
Quand Antigone veut accomplir son devoir, elle le fait au prix de lourds sacrifices, donnant ainsi un exemple troublant. Comme si le fait de respecter son devoir et de suivre sa raison étaient toujours teintés de tristesse : on fait le bien, mais paradoxalement cela se fait au détriment de notre propre joie. En ce sens, raison et passions sont souvent opposées, et la raison semble avoir une réputation austère. A tel point que l’on puisse se demander : Les privations que nous infligent le devoir ne risquent-elles pas de nous rendre malheureux ? Dans cette lettre adressée à la princesse Élisabeth, Descartes affirme que les grandes âmes se distinguent des âmes vulgaires par leur capacité à maîtriser leurs passions grâce à la raison. Cette maîtrise leur permet de transformer leurs afflictions en sources de bonheur et de force intérieure. L’auteur montre ainsi que la raison est la clé pour atteindre une félicité durable, indépendamment des circonstances extérieures. Nous verrons d’abord comment Descartes oppose les âmes vulgaires aux grandes âmes, avant d’examiner les moyens concrets de la maîtrise des passions, puis d’interroger les limites et les critiques possibles de cette conception.





