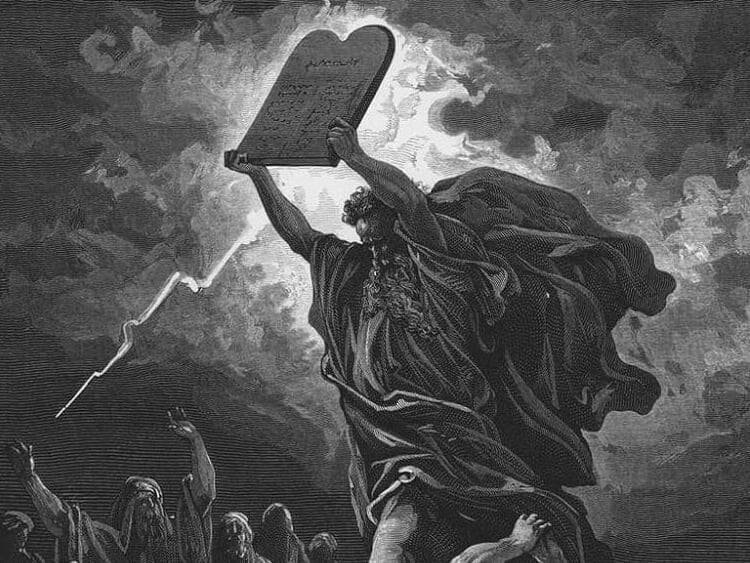La parabole du palais
S’approcher de la connaissance de Dieu, c’est reconnaître son éloignement
J’ouvre mon discours, dans ce chapitre, en te présentant la parabole suivante : Le souverain était dans son palais, et ses sujets étaient en partie dans la ville et en partie hors de la ville. De ceux qui étaient dans la ville, les uns tournaient le dos à la demeure du souverain et se dirigeaient d’un autre côté ; les autres se tournaient vers la demeure du souverain et se dirigeaient vers lui, cherchant à entrer dans sa demeure et à se présenter chez lui, mais jusqu’alors ils n’avaient pas encore aperçu le mur du palais. De ceux qui s’y portaient, les uns, arrivés jusqu’au palais, tournaient autour pour en chercher l’entrée ; les autres étaient entrés et se promenaient dans les vestibules ; d’autres enfin étaient parvenus à entrer dans la cour intérieure du palais et étaient arrivés à l’endroit où se trouvait le roi, c’est-à-dire à la demeure du souverain. Ceux-ci toutefois, quoique arrivés dans cette demeure, ne pouvaient ni voir le souverain, ni lui parler ; mais, après avoir pénétré dans l’intérieur de la demeure, ils avaient encore à faire d’autres démarches indispensables, et alors seulement ils pouvaient se présenter devant le souverain, le voir de loin ou de près, entendre sa parole, ou lui parler.
Je vais maintenant t’expliquer cette parabole que j’ai imaginée :
Quant à « ceux qui étaient hors de la ville », ce sont tous les hommes qui n’ont aucune croyance religieuse, ni spéculative, ni traditionnelle […]. Ceux-là sont à considérer comme des animaux irraisonnables ; je ne les place point au rang des hommes, car ils occupent parmi les êtres un rang inférieur à celui de l’homme et supérieur à celui du singe, puisqu’ils ont la figure et les linéaments de l’homme et un discernement au-dessus de celui du singe.
« Ceux qui étaient dans la ville, mais tournaient le dos à la demeure du souverain », ce sont des hommes qui ont une opinion et qui pensent, mais qui ont conçu des idées contraires à la vérité, soit par suite d’une grave erreur qui leur est survenue dans leur spéculation, soit parce qu’ils ont suivi ceux qui étaient dans l’erreur. Ceux-là, par suite de leurs opinions, à mesure qu’ils marchent, s’éloignent de plus en plus de la demeure du souverain; ils sont bien pires que les premiers, et il arrive des moments où il devient même nécessaire de les tuer et d’effacer les traces de leurs opinions, afin qu’ils n’égarent pas les autres.
« Ceux qui se tournaient vers la demeure du souverain et cherchaient à y entrer, mais qui n’avaient pas encore aperçu la demeure du souverain », c’est la foule des hommes religieux, c’est-à-dire des ignorants qui s’occupent des pratiques religieuses.
« Ceux qui étaient arrivés jusqu’au palais et qui tournaient autour », ce sont les casuistes qui admettent, par tradition, les opinions vraies, qui discutent sur les pratiques du culte, mais qui ne s’engagent point dans la spéculation sur les principes fondamentaux de la religion, ni ne cherchent en aucune façon à établir la vérité d’une croyance quelconque.
Quant à ceux qui se plongent dans la spéculation sur les principes fondamentaux de la religion, ce sont « ceux qui étaient entrés dans les vestibules », où les hommes se trouvent indubitablement admis à des degrés différents.
Ceux qui ont compris la démonstration de tout ce qui est démontrable, qui sont arrivés à la certitude, dans les choses métaphysiques, partout où cela est possible, ou qui se sont approchés de la certitude, là où l’on ne peut que s’en approcher, ce sont là « ceux qui sont arrivés dans l’intérieur de la demeure auprès du souverain.
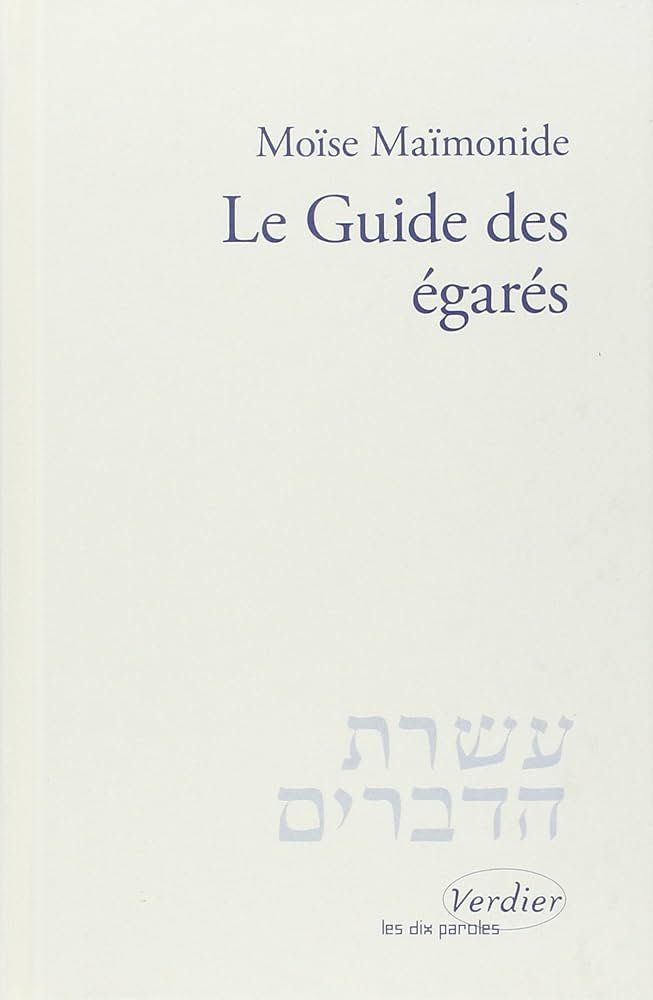
L'essentiel
Maïmonide utilise l’image d’un palais royal pour décrire les différents niveaux de connaissance de Dieu (et de proximité spirituelle avec lui).
Pour lui, le fait de se rendre au temple et d’observer les rites religieux ne suffit pas. Seuls ceux qui ont une connaissance juste et précise de leur Créateur peuvent être réellement proches de lui.
Par ailleurs, les érudits traditionnels, malgré leur science, restent à l’extérieur tant qu’ils ne pratiquent pas la démonstration rationnelle et la certitude philosophique.
Ce texte illustre ainsi la synthèse médiévale entre foi juive et philosophie aristotélicienne. On y perçoit la conviction que la raison n’est pas l’ennemie de la religion, mais au contraire le chemin royal vers Dieu.
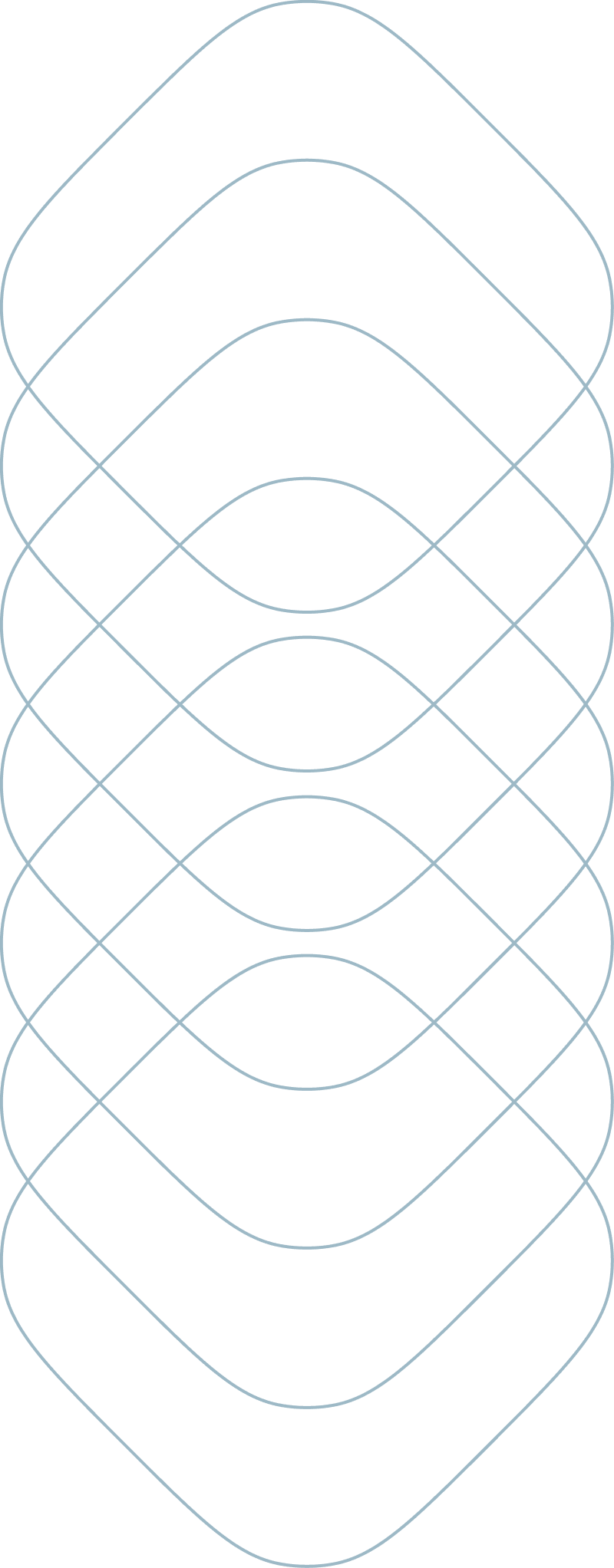
Des ressources pour aller plus loin
S’approcher de Dieu
« La croyance n’est pas quelque chose qu’on prononce (seulement), mais quelque chose que l’on conçoit dans l’âme, en croyant que la chose est telle qu’on la conçoit. »